
Le paradoxe des tarifs douaniers: Pourquoi la stratégie de Trump, largement rejetée, a toujours de puissants partisans - et ce qu'ils voient que les autres ne voient pas
Le paradoxe des droits de douane : pourquoi une stratégie largement rejetée a toujours de puissants partisans – et ce qu'ils voient que les autres ne voient pas
Dans les cercles restreints du monde universitaire de l'économie et des groupes de réflexion politique, peu d'arguments suscitent autant de haussements d'yeux collectifs que l'idée que les droits de douane pourraient relancer l'industrie manufacturière américaine. Le consensus est aussi durable que large : les droits de douane augmentent les prix, ralentissent la croissance, incitent aux représailles et atteignent rarement, voire jamais, les objectifs annoncés. Et pourtant, un groupe restreint mais déterminé au sein de l'entourage politique du président Donald Trump reste sceptique.

Ils ne se contentent pas de redoubler d'efforts sur les droits de douane, ils tentent de réécrire complètement les règles du jeu.
"Aux yeux de nombreux économistes, il s'agit d'une impasse politique", a déclaré un analyste qui conseille des investisseurs institutionnels. "Mais pour ce groupe, le pari ne repose pas sur la théorie des manuels, mais sur l'utilisation d'un levier typiquement américain, et sur un timing qui pourrait être plus favorable que ce que les critiques admettent."
Alors que les États-Unis évaluent leurs prochaines actions sur la scène mondiale et que le programme économique de Trump regagne en importance dans la sphère politique, une question provocatrice se pose : une théorie que la plupart des experts rejettent – des droits de douane soigneusement calibrés comme moyen de relance économique nationale – pourrait-elle réellement fonctionner dans des conditions spécifiques et limitées ?
À contre-courant : L'argument du droit de douane stratégique
Alors que la communauté économique au sens large considère les droits de douane comme un outil brutal avec plus de dommages collatéraux que d'avantages, le cercle de Trump défend une approche plus sophistiquée, ancrée dans une théorie économique obscure mais puissante.
Au cœur de cette stratégie se trouve la théorie du droit de douane optimal, une idée qui n'a de sens que lorsqu'elle est exercée par des pays disposant d'un pouvoir de marché suffisant.
La théorie du droit de douane optimal propose qu'un grand pays, capable d'influencer les prix mondiaux, peut améliorer son bien-être national en imposant un droit de douane spécifique. Ce droit de douane agit en améliorant les termes de l'échange du pays (en rendant les importations relativement moins chères), bien que cet avantage doive être compensé par les effets de distorsion du droit de douane.
Les États-Unis, en tant que premier importateur mondial, correspondent à cette description. La théorie postule qu'en imposant un droit de douane, un acheteur dominant comme les États-Unis peut effectivement forcer les fournisseurs étrangers à baisser leurs prix pour maintenir l'accès au lucratif marché américain.
Résumé de la part des États-Unis dans les importations mondiales de marchandises au cours des dernières décennies
| Année | Part des États-Unis dans les importations mondiales de marchandises | Valeur des importations américaines (biens) | Valeur des importations mondiales (biens) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | ~15% | Non spécifié | Non spécifié | WITA |
| 2019 | ~9% | 2,5 billions de dollars (environ) | Non spécifié | WITA, U.S. Census Bureau/BEA |
| 2022 | 14,6% | 3,37 billions de dollars | ~23 billions de dollars | TrendEconomy, Wikipedia, World Bank |
| 2023 | 13,1% - 14,6% | 3,11 - 3,2 billions de dollars | ~21 - 24,2 billions de dollars | Visual Capitalist, TrendEconomy, OEC, WTO |
| 2024 | ~13,8% | 3,3 billions de dollars | ~23,9 billions de dollars | Statista, WTO, World Bank |
"Il s'agit de transférer l'incidence du droit de douane", a déclaré un macro-stratège au fait des discussions politiques internes. "Si les entreprises étrangères absorbent une partie du coût, c'est de l'argent qui reste à l'intérieur de l'économie américaine au lieu d'en sortir."
Stephen Miran, un économiste qui partage ce point de vue, a cité des recherches universitaires suggérant qu'un droit de douane d'environ 20 % pourrait, en théorie, optimiser les termes de l'échange, renforcer l'industrie nationale et générer des recettes. Ces recettes, si elles étaient réinvesties judicieusement, pourraient financer la résurgence industrielle même que les critiques du libre marché affirment que les droits de douane détruisent.
Relocalisation par conception, pas par défaut

Un deuxième volet de l'argument repose sur les incitations à la relocalisation. En augmentant le prix relatif des importations, les droits de douane réduisent l'arbitrage de la délocalisation qui a évidé l'industrie manufacturière américaine pendant des décennies.
Tableau récapitulatif des différences et de la dynamique de l'arbitrage de la relocalisation et de la délocalisation.
| Aspect | Arbitrage de la délocalisation | Arbitrage de la relocalisation |
|---|---|---|
| Facteurs de coût | Tire parti des coûts de main-d'œuvre et de production plus faibles à l'étranger | Se concentre sur la réduction des coûts cachés (par exemple, les retards de transport) |
| Risques | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement, instabilité géopolitique | Coûts de démarrage plus élevés, défis de conformité réglementaire |
| Proximité du marché | Opérations éloignées des principaux marchés | Opérations plus proches des principaux marchés |
| Contrôle de la qualité | Potentiellement plus faible en raison de la distance | Améliorée en raison de la proximité |
| Orientation stratégique | Exploite les différences de salaires entre les pays | Améliore la réactivité et l'alignement sur le marché |
Dave Brat, ancien membre du Congrès et professeur d'économie, a publiquement défendu ce point de vue, considérant les droits de douane non pas comme une fin en soi, mais comme des catalyseurs qui "remettent le capital entre les mains des Américains". L'effet recherché est d'orienter les décisions des entreprises vers la production nationale, non pas par le biais de mandats, mais par le biais de signaux du marché.
"Si la délocalisation était logique lorsque la main-d'œuvre était bon marché et que les importations se faisaient sans heurts, que se passe-t-il lorsque ce calcul change ?", a demandé un initié politique. "Vous obtenez des investissements nationaux. C'est ça le jeu."
Cette théorie de la relocalisation induite par la différence de prix dépend de plus que de simples droits de douane. Le succès dépend de politiques complémentaires : incitations fiscales, formation de la main-d'œuvre, infrastructures et R&D. Dans ce modèle, les droits de douane ne sont pas des reliques protectionnistes, ce sont des incitations stratégiques intégrées dans un plan industriel plus vaste.
Pourquoi cela pourrait fonctionner, même si cela ne fonctionnera probablement pas
Ne vous y trompez pas : même les partisans admettent que les conditions de succès sont limitées. La stratégie repose sur une confluence de leviers économiques, de volonté politique et de retenue mondiale qui est rare, voire éphémère.
1. Le pouvoir de marché dans un monde multipolaire
Les États-Unis représentent encore près de 15 % des importations mondiales. Si une nation peut dicter ses conditions en tant qu'acheteur, ce sont bien les États-Unis. Un droit de douane correctement fixé pourrait contraindre les exportateurs à baisser leurs prix, en particulier s'ils dépendent fortement de la demande américaine.
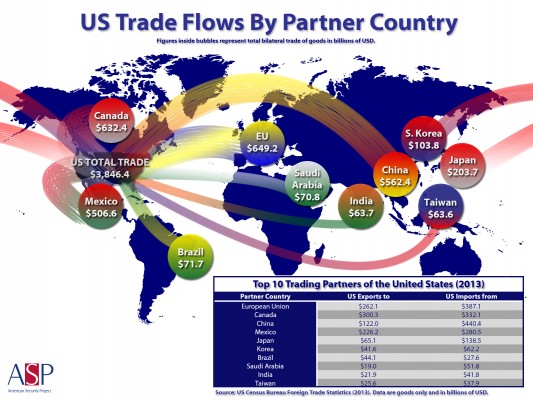
2. Des recettes pour un réinvestissement stratégique
Les droits de douane sont, en fait, des impôts. Mais contrairement aux impôts sur le revenu, ils sont prélevés sur les entreprises étrangères. Si ces recettes sont acheminées vers des initiatives stratégiques (énergie propre, semi-conducteurs, infrastructure numérique), elles pourraient servir à la fois de moyen de dissuasion et d'outil de développement.
Droits de douane annuels perçus aux États-Unis au cours des dernières années
| Année fiscale | Droits de douane perçus (en milliards de dollars) |
|---|---|
| 2024 | 88,07 |
| 2023 | 80,0 |
| 2022 | 111,8 |
| 2021 | 93,8 |
| 2020 | 78,8 |
| 2019 | 71,9 |
3. L'industrie manufacturière comme boucle de rétroaction
En théorie, les usines relocalisées ne se contentent pas de produire des biens, elles génèrent également des retombées technologiques, des emplois qualifiés et une vitalité économique locale. Au fil du temps, ces grappes peuvent devenir des écosystèmes qui s'auto-renforcent. Pensez à la Silicon Valley, mais pour l'industrie manufacturière de pointe.
4. La variable des représailles
C'est là que le rêve s'évanouit souvent. Les représailles sont la contre-attaque réflexe dans les guerres commerciales. Mais dans le meilleur des cas, les partenaires commerciaux ne réagissent pas de manière symétrique, ou le font dans des secteurs où les États-Unis ont moins à perdre. "Il faut de la retenue de la part des autres et de la discipline chez soi", a déclaré un expert en commerce. "C'est une combinaison rare."
Les critiques : Pas seulement des sceptiques, mais des détracteurs fondamentaux
Malgré la cohérence interne de la théorie, les économistes traditionnels restent profondément sceptiques. Leurs objections sont fondamentales : les droits de douane faussent les marchés, les représailles sont inévitables et aucun modèle n'a jamais montré de gains à long terme dus au protectionnisme.
"Ce n'est pas seulement une mauvaise politique", a déclaré un universitaire. "C'est une mauvaise interprétation de la gravité économique. On ne peut pas se frayer un chemin vers la compétitivité avec des droits de douane."
Leur argument repose sur l'histoire : les expériences passées en matière de droits de douane, de la loi Smoot-Hawley des années 1930 aux escarmouches commerciales modernes, ont eu tendance à provoquer l'inflation, à mettre à rude épreuve les alliances mondiales et à nuire aux consommateurs.
Saviez-vous que la loi Smoot-Hawley sur les tarifs douaniers de 1930 a eu un impact profond sur le commerce mondial ? Cette politique protectionniste a entraîné une baisse significative des volumes du commerce international, le commerce mondial chutant d'environ 66 % entre 1929 et 1934. Aux États-Unis, les importations sont passées de 4,4 milliards de dollars à 1,5 milliard de dollars, et les exportations ont chuté de 5,4 milliards de dollars à 2,1 milliards de dollars au cours de la même période. La loi a déclenché des représailles tarifaires de plus de deux douzaines de pays, ce qui a encore exacerbé le ralentissement économique et contribué à la gravité de la Grande Dépression. Cet événement historique sert de mise en garde quant aux conséquences potentielles des politiques commerciales protectionnistes sur la stabilité économique mondiale.
De plus, l'idée que les entreprises américaines se relocaliseront de manière significative sans s'attaquer aux problèmes structurels tels que les coûts des soins de santé, la complexité de la réglementation et les lacunes de la main-d'œuvre frappe les critiques comme étant naïve.
Entre idéologie et instrument
Alors, pourquoi poursuivre une stratégie que la plupart des économistes rejettent ?
Parce qu'elle redéfinit la politique économique comme un exercice de pouvoir, et non d'équilibre. Dans ce contexte, les droits de douane ne sont pas de simples taxes, mais des soupapes de pression, des atouts de négociation et des signaux d'investissement. Ils représentent un passage de la passivité néolibérale à l'activisme industriel.
Saviez-vous que le néolibéralisme est une philosophie économique axée sur les marchés libres, la privatisation, la déréglementation et une intervention minimale de l'État ? Devenue prééminente à la fin du XXe siècle sous des dirigeants tels que Margaret Thatcher et Ronald Reagan, elle prône l'austérité budgétaire, la mondialisation et la réduction du pouvoir des syndicats afin de stimuler l'efficacité et la croissance économique. Bien qu'elle ait influencé des politiques telles que les accords commerciaux et la déréglementation des industries, le néolibéralisme est souvent critiqué pour avoir accru les inégalités économiques, sapé la démocratie et négligé les préoccupations environnementales et sociales. Son impact reste un sujet brûlant dans les débats sur les systèmes économiques modernes.
Il ne s'agit pas d'un retour au protectionnisme du XXe siècle. Il s'agit d'une tentative d'utiliser l'effet de levier de la demande dans un monde où les rivalités géopolitiques remodèlent les chaînes d'approvisionnement. Et même si cela peut être risqué, certains soutiennent que le risque lui-même fait partie de la stratégie.
"Pendant trente ans, nous avons optimisé l'efficacité", a déclaré un conseiller en investissement. "Il est peut-être temps d'optimiser la résilience, même si cela signifie briser certains anciens modèles."
Une renaissance ou un mirage ?
Les enjeux sont énormes. Si le pari échoue, les consommateurs paient plus cher, les alliés ripostent et les entreprises se contentent d'adapter leurs chaînes d'approvisionnement à d'autres régions à bas coûts. Mais si les conditions sont réunies, si les représailles sont limitées, si les recettes sont réinvesties intelligemment, si la relocalisation devient autonome, alors ce qui semble aujourd'hui improbable pourrait devenir transformateur.
Ce n'est pas le chemin le plus probable. Mais aux yeux de ses défenseurs, c'est un chemin qui mérite d'être exploré. Non pas parce qu'il est conforme au consensus, mais précisément parce qu'il ne l'est pas.
"Toute stratégie semble impossible jusqu'à ce que les conditions changent", a déclaré un analyste. "Et les conditions changent plus vite qu'on ne le pense."
Le mot de la fin
Dans un monde de plus en plus défini par le nationalisme économique, le découplage stratégique et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, le débat sur les droits de douane n'est plus une relique des batailles idéologiques passées, mais une question d'actualité concernant l'architecture économique future.
Laisser de côté à vos risques et périls.
